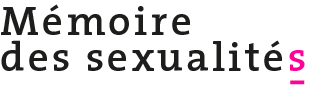Les luttes trans pour déconstruire les “normes de genre”
Dans Marseille trop puissante, à paraître aux éditions Hors d’atteinte, 33 femmes racontent à Margaux Mazellier comment elles ont tenté de rendre Marseille plus vivable. Pour Marsactu, l’autrice présente en avant-première les portraits de certaines d’entre elles. Dans ce troisième épisode, rencontre avec Karine Espineira, co-fondatrice de l’association Sans contrefaçon, par Margaux Mazellier, le 23 Jan 2024
Si dans les années 2000, plusieurs associations et collectifs sont passés à côté de la question du genre et plus particulièrement de la transidentité, l’association Sans-contrefaçon menait déjà un travail de sensibilisation considérable à Marseille. À son origine, la sociologue des médias Karine Espineira, qui vit aujourd’hui dans le Finistère avec son épouse.
Sans contrefaçon a permis de visibiliser la question de la transidentité au sein des mouvements féministes et LGBTQIA+ à Marseille. Dans le sillage de la revue 3 Keller du Centre gay et lesbien de Paris ou encore du collectif Le Zoo fondé par le sociologue et activiste transféministe Sam Bourcier qui diffusait dans les années 1990 les théories queer. Pour Karine Espineira, l’association a ouvert la réflexion, »non plus sous le prisme de simples
témoignages autour de l’opération et de la prise d’hormones, mais comme une façon d’interroger les limites de notre société binaire ». Une démarche qui rejoint son parcours personnel.
« J’étais en mode survie. Il fallait que je fasse quelque chose »
Karine est née en 1967 à Santiago, au Chili, d’une mère française d’origine gréco-russe et d’un père chilien. Elle me raconte qu’elle a ressenti un malaise lié à son identité très tôt : »Dire que je savais exactement de quoi il s’agissait ne serait pas vrai, ça reviendrait à faire un anachronisme en posant des mots d’aujourd’hui sur ce qui était à l’époque un mal-être. Mais, ce que je peux dire, c’est que la socialisation en tant que petit garçon qu’on me proposait ne me convenait pas ». En mars 1974, elle fuit le Chili pour la France avec sa mère et sa petite sœur. Son père les rejoint au bout de quelques mois. Elles s’installent à Marseille avant de poser leurs bagages, quelque temps plus tard, dans la ville de Manosque où il a trouvé du travail. Karine passe son adolescence dans l’une des cités HLM de la ville : « Le malaise que je ressentais au Chili était toujours présent. Mais la société nous apprend à
repousser ce genre de sentiments, à trouver des stratégies pour les étouffer ».
L’année de ses 20 ans, elle subit un grave accident de voiture dont elle met quatre ans à se remettre. Les médecins lui prescrivent alors des stéroïdes, ce qui bouleverse son corps et déclenche en quelque sorte sa puberté : »J’ai commencé à perdre mes cheveux, à développer une pilosité… ».
À l’époque, Karine ne dispose d’aucune représentation de personnes trans : »La seule image que j’avais, c’était celle du bois de Boulogne, ce qu’on voit dans les séries noires : la prostitution, la drogue, la pègre… Où, soit tu meurs, soit tu t’autodétruis ». Karine se dit que pour pouvoir entamer un projet de transition, elle doit s’armer : « J’avais perdu tout mon capital physique, alors je me suis dit qu’il me fallait des diplômes. Plein de diplômes ». En 1988, elle part donc faire des études à la fac de Grenoble. Ce n’est qu’en 1995 que la question de sa transition se pose à nouveau : »Je n’y arrivais plus, j’étais en mode survie. Il fallait que je fasse quelque chose ».
J’ai fait un suivi court parce que j’ai quitté le suivi psychiatrique, que je trouvais inacceptable.
En 1996, elle s’installe à Paris et, avec l’aide de l’Association du syndrome de Benjamin (ASB) et de son épouse actuelle Maude Yeuse Thomas, elle fait une « transition express » : « J’ai fait un suivi court parce que j’ai quitté le suivi psychiatrique, que je trouvais inacceptable. Pour ma vaginoplastie, j’ai négocié d’être hospitalisée moins longtemps avant et après l’opération car c’est ce qui coûte le plus cher ». Elle choisit d’aller en Belgique pour être « opérée de façon correcte »: »Je voulais un clitoris sensitif, ce qui n’était pas garanti en France où la question du plaisir et de la sexualité ne se posait pas pour les femmes trans, dont on considérait qu’on leur rendait déjà service en leur permettant d’avoir un vagin et de changer d’état civil ». « La transphobie est une émanation du sexisme »
Au fur et à mesure de son engagement et de sa transition, Karine réalise que la société attend des personnes trans un certain type de comportement : »Les protocoles hospitaliers fabriquent de vrais hommes et de vraies femmes. Dans le cadre du suivi psychiatrique, il faut arriver en jupe et maquillée pour démontrer que ce qu’on dit est vrai, qu’on fait une transition parce que c’est dans l’autre genre qu’on s’épanouit. Il faut prendre tous les stéréotypes possibles et les porter. Si on ne le fait pas, on est foutu·e ». Selon elle, la société place les personnes trans face à une double injonction paradoxale : « Soit on n’adhère pas assez aux normes et on nous dit qu’on n’est pas de vrai·es trans, soit on le fait et on renforce les normes de genre ».
Pour elle, cela révèle combien la société est sexiste : »La transphobie est une émanation de ce sexisme. Les gens dans l’espace public cherchent les hommes et les femmes et tout ce qui est au milieu est considéré comme anormal ». Mais ce n’est qu’au début des années 2000 que les associations trans se politisent vraiment, explique Karine : « À l’époque, il y a le Support transgenre Strasbourg 67 (STS) et le Groupe activiste trans (GAT) à Paris. C’est notamment à partir de là que les hommes trans ont posé des questions féministes sur la table ». Karine et Maud vivent ce changement de paradigme depuis Marseille, où elles sont venues s’installer fin 1998. En 2005, elles décident de créer l’association Sans contrefaçon.
Elles organisent des rencontres en partenariat avec le fond documentaire Mémoires des sexualités, des cycles de débats aux 3G, bar associatif à la Plaine, ou encore des ateliers dans le cadre des Universités d’été homosexuelles (UEH) : »On a par exemple imaginé une rencontre entre quatre femmes lesbiennes, deux trans et deux cis. On a parlé de sexualité, de politique, de musique… sans tabou ». Un atelier qui avait bouleversé certaines participantes, se souvient-elle : »L’une d’elles est venue me voir à la fin pour me dire que jusque-là, elle s’était opposée à la présence de femmes trans dans les milieux lesbiens mais que, depuis qu’elle nous avait écoutées, elle le regrettait ».
En 2009, le couple décide de mettre l’association en sommeil. Le fonds documentaire amassé est donné à l’association Genres de luttes, qui a pour objectif la création d’un fonds d’archives et d’un centre documentaire à Marseille sur les luttes trans, la transphobie et les transidentités. Le couple se met définitivement en retrait de la vie associative en 2013 et passe le relais au T-Time, une association féministe à direction des personnes trans et intersexes.