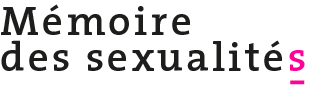Homosexualité dans la chanson française
(source : Wikipédia)
L’homosexualité dans la chanson française peut prendre plusieurs formes. Au fil des époques les chansons peuvent caricaturer, ignorer, défendre ou militer pour l’acceptation de cette orientation sexuelle, quelle que soit l’orientation sexuelle de leurs auteurs ou de leurs interprètes. Mode d’expression populaire par excellence, la chanson permet à la fois le divertissement et le débat. La culture gay et lesbienne en a fait un médium privilégié d’expression, mais la chanson peut être également utilisée pour la railler ou la parodier.
Histoire
 André Claveau lors du Concours Eurovision de la chanson 1958 à Hilversum.
André Claveau lors du Concours Eurovision de la chanson 1958 à Hilversum.
Déjà présente à une époque où le terme « homosexuel » n’existait pas encore, le thème de l’homosexualité a véritablement éclos dans la chanson française à l’avènement de la Troisième République grâce à l’explosion des cafés-concerts — à la suite des décrets de 1867 et de 1880 —, lieux de toutes les licences (qu’elles soient alcooliques ou morales) malgré une censure toujours attentive. Il s’agissait à l’époque plus de caricaturer la « tante » comme sujet de moquerie parmi tant d’autres (soldats, belles-mères…), même si peu à peu des artistes et auteurs ouvertement homosexuels tendent à donner une image plus troublante, sortant de la moquerie pour évoquer la vie homosexuelle de l’époque et l’ivresse de ces amours interdites.
Du sous-entendu grivois distillé par Yvette Guilbert, Suzanne Lagier ou Charlotte Gaudet à l’apparition du style « tapette » popularisé par Mayol (et rapidement parodié, parfois de façon non subtile), le XXe siècle franchit allègrement le pas. À l’image des milieux littéraires qui voient s’épanouir Marcel Proust, André Gide, Colette ou Jean Cocteau, les music-halls deviennent des pépinières d’artistes « invertis », ainsi que des lieux de drague très courus. C’est le règne de la chanson interlope. Bien sûr, le voile de l’ambiguïté plane toujours la plupart du temps sur les textes, mais la vie privée des vedettes des « années folles » est de notoriété publique : les producteurs Henri Varna et Oscar Dufrenne, le compositeur Gaston Gabaroche, les auteurs Jean Lorrain, Maurice Aubret et Louis Amade ne cachent pas leurs préférences. Le bal du Magic-City, inauguré en 1922 rue de Lappe, organise chaque année au Mardi gras un grand concours de travestis. Charpini ou O’dett triomphent en précurseurs des drag queen dans des parodies d’opérette ou des imitations de comédiennes célèbres. Les chanteurs Reda Caire, Max Trébor, Jean Lumière, André Claveau, Jean Tranchant ou Jean Sablon font rêver les femmes sans qu’elles soient dupes. Côté femmes, Fréhel, Damia, Suzy Solidor ou Yvonne George profitent de la brèche ouverte par le roman à scandale La Garçonne de Victor Margueritte pour s’approprier des textes « masculins1. »
La Seconde Guerre mondiale incite à plus de discrétion, qui plus est à partir de la loi du 6 août 1942 sur l’incitation à la débauche2, même si le style zazou de Charles Trenet véhicule toujours quelques sous-entendus. La Libération en revanche est une période de remise aux normes assez brutale que l’arrivée du « rock », symbole de virilité, ne contredira pas. Luis Mariano, Jean-Claude Pascal, Mick Micheyl ou Colette Mars se retranchent prudemment derrière les convenances face à l’expansion d’un discours homophobe sous le masque de la caricature. D’autres comme Gribouille se réfugieront dans l’alcool et les barbituriques, elle en mourra le 18 janvier 1968.
C’est paradoxalement grâce à des chanteurs « hétéros » que l’homosexualité va peu à peu devenir un sujet plus anodin à partir de 1968. Juliette Gréco, Régine ou Mouloudji interprètent des auteurs ouvertement gays comme Frédéric Botton ou Jean Genet, et surtout des textes qui évoquent l’homosexualité sans en faire un objet de condamnation ou de moquerie. Charles Aznavour aborde le sujet en 1972 avec Comme ils disent en énonçant pour la première fois « homo » (écrit homme oh) et en prêchant la tolérance3.